Une présentation du bureau pays du Fonds mondial pour la nature explique que ces espaces, du point de vue économique, ne sont pas rentables bien qu’ayant des retombées écologiques. Ce travail présenté le 12 septembre à Yaoundé au cours d’un atelier propose d’autres opportunités aux pays du bassin du Congo
Dans le cadre de l’initiative Commission des forêts du bassin du Congo (Comifac) et Fonds mondial pour la nature (WWF) pour l’amélioration des flux internationaux de financement des forêts du bassin du Congo, un atelier d’apprentissage et de sensibilisation s’est tenu le 12 septembre 2024 à Yaoundé.
Au cours de cet atelier facilité par les ministères des Forêts et de la Faune (Minfof) et de l’Environnement de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) en présence des représentants de la Comifac, des organisations de la société civile et des partenaires au développement le WWF a fait une présentation sure : « Augmenter les flux de financements pour les forêts à haute intégrité du bassin du Congo ».
Les forêts à haute intégrité ont un gain sur le plan écologique mais ne rapportent pas économiquement parlant, selon l’expert Jonas Kemajou Syapze. Pour qu’un projet carbone puisse être rentable, a-t-il indiqué, il doit être mené dans une zone où le taux de déforestation se situe à au moins 2%. Ce qui n’est pas le cas pour les forêts du bassin du Congo.
Le bassin du Congo, aujourd’hui présenté comme le premier poumon écologique, par certains experts à cause d’un taux de déforestation très bas, compris entre 0,01% et 0, 33%, fait face aussi à la faible compensation de ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jonas Kemajou insiste donc pour dire qu’avec ce taux de déforestation, considéré comme bas, ce bassin ne peut pas tirer des dividendes importants s’il se contente uniquement de développer des initiatives portées vers le marché carbone. Il ne s’agit pas d’un mauvais montage des propositions.
En fait, au Cameroun, certains citent souvent des exemples de projets carbone bien ficelés, comme le « Landfill Gas and Use » tout premier projet de « Mécanisme de développement propre » porté par Hysacam, la société en charge de la collecte des déchets, qui envisageait de produire de l’énergie électrique et du biogaz à partir des ordures qui n’a pas bénéficié des financements.
Comment alors valoriser ce potentiel en ressources naturelles de cette sous-région qui compte 180 millions d’hectares de forêt, 145 millions d’hectares de tourbière, plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d’oiseaux et 700 espèces de poissons entre autre, avec une population de 185 millions d’âmes,, mais qui entre 2017 et 2021, n’a reçu que 4% de financements attendus ? Plus grave encore, va regretter le Minfof, Jules Doret Ndongo, ces financements se déclinent en près de 68% d’aide au développement déguisée et seulement 24% environ de dette.
L’agro-industrie génère 750 dollars américains à l’hectare
C’est ainsi qu’est née en 2022 à Charm el-Cheick en Egypte, lors de la 27ème Conférence des parties sur les changements climatiques (Cop27) l’initiative Comifac-WWF, sous l’impulsion de Jules Doret Ndongo, alors Président en exercice de la Comifac. Il s’agit de scruter d’autres pistes pour que les pays du bassin du Congo puissent trouver des moyens pour améliorer les conditions de vie de leurs populations. Pour le Minfof, les nouvelles approches doivent être examinées pour une bonne transition vers l’économie verte.
Grâce à la gestion durable de ses forêts, le bassin du Congo, permet d’enregistrer 50% des précipitation du Sahel, un taux qui pourra connaître une réduction de 16% si rien n’est fait pour compenser ces efforts de conservation. Un défi important, à en croire Alain Ononino, le Directeur national du WWF. « Sans financement adapté, les risques de conversion à grandes échelles des terres forestières sont importants avec des impacts négatifs sur la biodiversité et la régulation du climat », s’est inquiété le Directeur du WWF. Quels choix faire si justement la contribution du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas valorisée à sa juste valeur ? Jonas Kemajou Syapze pense que l’agro-industrie qui génère 750 dollars américains à l’hectare et l’exploitation minière qui, elle aussi est rentable peuvent être des voies importantes de recours.
Un a semblé fédérateur au vu des interventions des participants dont Augustine Njamnshi, expert en justice climatique bien connu dans les négociations climat ainsi que Jean Abbé, activiste dans le sous-secteur forêt-environnement. « Il faut sortir de dons et promouvoir nos ressources », a indiqué Augustine Njamnshi.






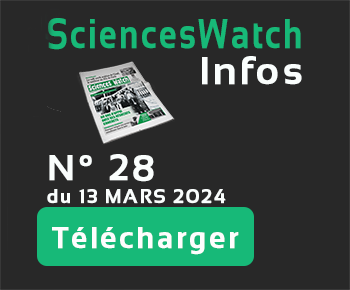












Commentaires 0