Face à la montée en puissance des mouvements anti-droits, la surpression ou la réduction des aides au développement n’épargnent pas le devenir des DSSR ; une réflexion sur quelques esquisses de réponses a eu lieu le 23 octobre à Conakry
Par Adrienne Engono Moussang, à Conakry
S’il est reconnu par beaucoup que, comme acte médical, les soins complets d’avortement sont un droit inaliénable, il reste que dans plusieurs pays, non seulement ce service est restreint et même interdit, mais aussi qu’il est classé dans le groupe des maladies orphelines, qui ne bénéficient d’aucune attention et d’aucun budget. A plusieurs niveaux des jeunes filles et femmes se voient privées de ce droit. En contexte hostile et difficile, il n’est pas garanti de compter sur les financements extérieurs ; es crises humanitaires, qui pourraient s’accentuer avec le changement à la tête de certains pays et les revendications socio-politiques qui obligent les citoyennes aux déplacements exacerbent cette situation et beaucoup plus chez les personnes vivant avec un handicap. Des Droits sexuels et se muent en service de luxe parce que les bailleurs de fonds ont peur d’engager leurs moyens.

Osylvia Akpaki, responsable finance de l’organisation non gouvernementale Jeunesse Regard et Actions basée au Bénin, propose, comme solution à ce problème : « le travail avec des entreprises privées pour que les droits sexuels et reproductifs soient pris en compte dans leurs Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), encourager la mutualisation des organisations à travers le partage des locaux et des espaces, par exemple, l’organisation des activités militantes telles que des défilés de mode, des festivals, des concerts, bref des évènements récréatifs et instructifs, organiser des levées de fonds communes pour les associations féminines. » le jeune féministe ajoute qu’ : « Il a été aussi suggéré de négocier avec les gouvernements pour que soit insérée une ligne de financement flexible pour soutenir les organisations féministes étant donné qu’elles contribuent, à travers leur travail à la réduction de la mortalité maternelle. »
.jpeg)
Osylvia Akpaki
Déclaration d’Abuja
En fait, l’Objectif de développement durable (ODD N°3) prévoit que les Etats partie ramènent le taux de mortalité maternelle à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cet engagement pris lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 sera évalué, comme les 16 autres ODD, en 2030, dans le cadre de l’Agenda 2030. L’incidence de l’avortement non-thérapeutique est d’au moins 20% dans la plupart des pays africains. Au Cameroun, par exemple, les travaux des experts de la santé de reproduction révèlent qu’au moins 20 décès sur 100 femmes perdent leur vie en voulant procréer. Les impacts de ces décès sur la vie des familles et de la société tout entière sont inestimables. Or, offrir des services d’avortement aux filles et femmes limite tous ces impacts et les dépenses.
Le Cameroun avait signé la déclaration d’Abuja pour l’octroi de 15% de son budget annuel à la santé. Près de 20 ans après cet engagement, l’enveloppe de la santé oscille entre 5 et 6%, tandis que le taux de mortalité maternelle, parmi les plus élevés de l’Afrique se situe à 406 décès pour 100.000 naissances vivantes.




.jpeg)



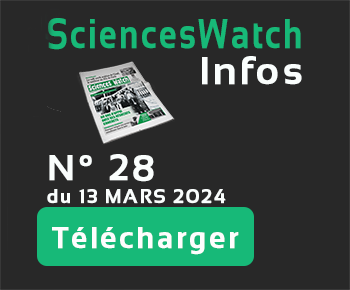











Commentaires 0