Les chiffres du ministère de l’Industrie des Mines et du Développement technologique (Minmidt) révèlent qu’en 2020 par exemple, 19 des 39 permis de recherche étaient consacrés à l’or. Le Minmidt et la principale structure sous-tutelle sont lancés dans la logique de constituer une réserve d’or importante comme trésor public au Cameroun. Le pays veut compter sur le potentiel de son sous-sol, souvent qualifié de scandale minier, pour son émergence à l’horizon 2035. Mais les répercussions fâcheuses de l’activité minière sur l’environnement et les humains nécessitent une réflexion plus logique et poussée. A qui profitera l’émergence au péril des citoyens ?
Pas forcément à Philomène Mbangoué. La cinquantaine sonnée, elle passe son temps au milieu des siens en cet après-midi du 1er août 2024. Dans la cour de sa concession où elle s’est allongée dans un vieux matelas, une tombe fraîche côtoie celle de son fils Rodrigue Maro, décédé il y a trois ans environ dans un trou minier. La sépulture est celle de sa génitrice, décédée trois semaines plus tôt. Les cheveux encore très ras sur sa tête en témoignent.
Le quotidien de cette dame n’est pas facile. Dans une petite marmite posée à côté du foyer dans un coin de la cour, un peu d’« Aposa », feuilles de manioc cuites avec un peu de sel et de piment, sans une seule gutte d’huile. Une des femmes qui l’assistent se charge de servir cette composition accompagnée de la pâte faite à base de farine obtenue après fermentation et séchage du manioc aux enfants et aux visiteurs. « Voilà ce avec quoi nous nous nourrissons. Notre vie a basculé depuis le départ de notre fils », se lamente Philomène Mbangoué. Son fils Rodrigue est parti pour l’au-delà. Il était son unique fils et son seul espoir, puisqu’elle reconnaît que de son vivant, il résolvait ses problèmes, aujourd’hui, elle n’a personne pour l’aider.
Si Mme Mbangoué a pu rester dans la concession où l’a laissée son mari décédé et son défunt fils, la veuve de Rodrigue Maro s’est trouvé une autre famille. « Elle est partie pour un autre mariage. Elle était encore très jeune et ne pouvait pas rester ici dans ces conditions difficiles. J’ai gardé deux des trois orphelins tandis que le troisième est avec elle. Je suis une agricultrice et avec la baisse des récoltes que nous connaissons ces temps, je peine pour leur scolarité. L’aîné est au cours préparatoire et le deuxième à la Sil », confie Philomène Mbangoué.

Les mêmes causes ont produit les mêmes effets dans la famille Doula où Wilfried Minkonda a péri dans les mêmes circonstances aux mêmes jour et heure que Rodrigue Maro. Le village avait alors perdu sept de ses dignes enfants ce jour-là. Ghislain Doula, le frère du regretté Wilfried a confié à Sciences Watch Infos comment la nouvelle du décès de ce dernier avait bouleversé la famille.
En fait, le jeune homme était conducteur de moto. Informé du « Sasayé », (journée d’accès libre au puits d’or qu’a offerte le Chinois), il va se rendre à la recherche de l’or sans en informer ses parents. Ceux-ci ne vont apprendre que son décès, noyé dans le trou suite à un éboulement. Dans cette famille aussi, la veuve, encore très jeune, est allée se remarier. Les orphelins ont besoin de moyens pour aller à l’école.
Pour ces familles, comme pour celles des cinq autres victimes, l’espoir repose entre les mains de la justice qu’elles ont saisie grâce à l’accompagnement des organisations de la société civile. Il n’est pas question de ramener les victimes, puisque c’est impossible, recadre Arthur Doula, mais de verser aux familles une indemnisation conséquente afin d’assurer un avenir aux orphelins.
Seulement, Philomène Mbangué, quant à elle semble déjà désespérer. Elle dit ne plus avoir d’information sur le déroulement du procès.
Or, selon leur avocat, Me Dieudonné Tejissié, contacté au téléphone : « la proposition d’indemnisation faite par la société Wang Zu Ping ne nous satisfaisait pas en son temps. Pour l’instant Me Jean Jacques a joint Mme Wang qui est actuellement au Mali et qui sera de retour d’ici le 27 août. Celle-ci veut régler le problème des dommages et intérêts des victimes pour qu’on en parle plus », déclare l’avocat. « Nous allons saisir la main tendue des Chinois afin de permettre aux familles des victimes de recevoir une indemnisation considérable à l’effet de faire leur deuil sereinement », pense-t-il. « Il y a aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des populations qui envahissent les mines en permanence. Malheureusement, c’est la responsabilité de l’Etat du Cameroun », se désole Me Tejissié.
A la question de savoir si l’Etat prend l’engagement dans les contrats de combler les trous après l’exploitation de la mine ? « Il est de la responsabilité des concessionnaires de fermer les excavations. L’Etat doit engager des sanctions contre les contrevenants et l’article 205 du code minier de 2016 exige une transaction financière préalable avec le concessionnaire. Le délégué, le ministre et tous les directeurs de l’administration en charge des mines ne font pas leur travail », va répondre Me Dieudonné Tedjissié.
L’organisation non-gouvernementale (Ong) Forêt et développement (Foder) a recensé, sur 93,66 hectares, 703 trous miniers dont 139 lacs artificiels. Ces espaces béants ont causé 205 décès dans l’Adamaoua et à l’Est, entre 2014 et 2022, d’après une étude de Foder. La responsabilité incombe aux entreprises, selon le code minier de 2016.
Batouri sur les traces de Kambélé III
.jpg)
Le chef-lieu du département de la Kadei, dans la région de l’Est, Batouri, pour ne pas le nommer, ploie depuis le 2 juillet dernier sous le poids du permis de recherche « Koubou Est », enregistré au N° 858. L’arrêté a été signé par le ministre par intérim des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt) Fuh Calistus Gentry, à l’entreprise Xin Yuan Mining Sarl, qui a à sa tête Hong Wenquiang. Le Chinois est autorisé à explorer l’or et les substances connexes dans l’arrondissement de Batouri.
Si l’on considère que l’exploration permet au détenteur d’un permis de sonder le sous-sol aux fins de déterminer ses potentialités minières, celui attribué à Hong Wenquiang fait déjà des vagues auprès de certains défenseurs de l’environnement. « On s’est souvent retrouvé avec des entreprises, pourtant venues pour l’exploration, qui exploitent l’or et nous abandonnent avec des gros trous béants qu’elles ne referment pas avec des impacts négatifs sur les activités comme l’agriculture de proximité qui n’existe plus, avec des forêts dévastées », a expliqué Gaston Omboli, Coordonnateur du Centre de protection de l’Environnement et de défense des intérêts communautaires (Cepedic), rencontré à Batouri. Ce dernier reste très prudent pendant l’échange qu’il nous a accordé. Le sujet est délicat et complexe. Comme souvent, l’information disséminée à Batouri attribue la décision à Yaoundé et les populations riveraines ne doivent que se soumettre. Elles qui n’ont pas été consultées au préalable.
Le sort subi par Kambélé III suscite des frayeurs auprès des habitants de Batouri.
En fait, à Kambélé III, l’exploitation de l’or a imposé des migrations aux fils et filles. Du village La chefferie a été contrainte de changer de site avec tous les symboles et patrimoines traditionnels. Son ancien site est reconnaissable actuellement par l’un des plus grands lacs formés par les chercheurs d’or. Les parents et les proches du chef, sa majesté Baba, qui jusque-là, reposaient paisiblement dans le caveau familial, ont été exhumés et enterrés à Batouri. Du coup l’annonce de l’existence d’un permis de recherche à Batouri suscite déjà des interrogations sur ce qui va advenir si l’exploitation de l’or se concrétise dans le chef-lieu du département de la Kadéi. Le chef insiste lui aussi sur la nécessité d’impliquer les populations, ou du moins, de les consulter lorsqu’il y a un projet qui peut avoir des impacts sur leur quotidien. « Nous ne saurons nous opposer aux actions de développement engagées par l’Etat mais nous devons en être informés à temps », insiste l’autorité traditionnelle qui a reçu l’équipe de Sciences Watch Infos dans sa maison de recasement faite en matériau provisoire.
Droit exclusif sur 41 km² environ
Jusqu’au 26 juillet 2024, le Coordonnateur du Cepedic s’interrogeait sur le sérieux de cette activité au vu de l’épaisseur aussi « maigre » de l’enveloppe. « J’ai vu les coûts à verser à l’Etat ; 170 millions FCFA et 24 millions FCFA quelque part. Une opération de recherche se chiffre à des milliards FCFA. Il y a quelque chose qui ne va pas », s’indigne M. Omboli. Il peut se féliciter de l’action des autorités en charge des mines qui ont ouvert une brèche pour le dialogue avec des forces vives de Batouri.
Des concertations, il est ressorti que : la ville de Batouri soit préservée des activités minières semi-mécanisées, que les populations soient sensibilisées, que le permis soit modifié en faveur d’une personne morale choisie par les élus locaux . L’on se demande pourquoi sortir d’un cadre technique pour un cadre politique (élus locaux) au lieu de créer un comité de surveillance qui intègre aussi les autorités traditionnelles de la Kadéi.
L’activité de l’entreprise chinoise va s’étaler sur trois ans, renouvelable trois fois au plus pour des périodes de deux ans chacune avec un droit exclusif sur 41 km² environ.
Pour bien de ressortissants de Batouri, le permis de recherche attribué le 2 juillet dernier semble voiler certaines réalités. Batouri n’a plus besoin d’une telle activité. Dans la mesure où, renseigne un riverain « En 2009, African Aura, une société d’exploration dans les domaines de l’or, du fer, et de l’uranium a réalisé un travail qui révèle que les derniers résultats de forage-impliquant 55 trous pour un total de 5 671 m- ont confirmé la présence de ce qu’elle décrit comme « un système aurifère significatif ». Information aussi disponible sur le site de cette entreprise.
Mercure et cyanure à toutes les sauces

Le village Koumbé Tiko, dans l’arrondissement de Ketté, département de la Kadéi, n’a jamais aussi été mouvementé. A un kilomètre par-là du centre une piste sans grand attrait, parsemée de granite, s’élargit au fur et à mesure que l’on la parcourt.
A environ deux kilomètres de l’axe principal, un cours d’eau. « Cette rivière s’appelle Mare », indique un natif du village Koubé Tiko. Le cours d’eau a été dévié par des engins qui creusent à longueur des journées ; ce depuis quelques mois. Le travail ici se fait à la chaine, essentiellement par des engins qui creusent, écrasent, lavent et tamisent les mottes de terre pour y extraire de l’or. Des dizaines de villageois (hommes, jeunes, femmes allaitantes et mineurs se ruent sur tranchées créées par les engins qui creusent. A leur risques et périls, ils esquivent tant bien que mal les mottes de terre parties du sommet et qui échouent dans les tranchées.
« Il s’agit de l’or alluvial, en provenance des sites miniers et déposé dans les cours par l’érosion », explique un expert minier. Selon lui, cette activité est totalement illégale et clandestine. Car, le code minier n’autorise pas la délivrance des permis d’exploitation de l’or dans les cours d’eau. Mais au Cameroun, indique notre expert qui n’a pas accepté d’être cité, les autorités locales traitent avec des exploitants en accord avec la famille; « cette exploitation est très néfaste pour l’environnement. Les métaux lourds utilisés pour laver l’or se déversent directement dans le cours d’eau, contrairement à l’exploitation sur la terre ferme où il atteint les rivières par infiltration », prévient l’expert minier.
Ce qui explique qu’en 2022, un travail du Centre pour l’environnement et le développement (Ced), une organisation de défense de l’environnement basée à Yaoundé a relevé qu’à peu près 40 litres de mercure et de cyanure étaient déversés chaque jour dans les cours d’eau autour de Kambélé III. La même année, une étude de l’organisation non-gouvernementale Forêt et développement (Foder) située à Yaoundé, indiquait que sur un échantillon de 60 orpailleurs prélevés, 43 (71,7%) avaient une concentration de mercure au-dessus de la normale prescrite par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). La concentration s’observait sur les cheveux. Le Ced va plus loin pour avertir que les poissons pêchés dans les eaux du département de la Kadéi, tout comme le bétail qui s’y abreuve, sont contaminés par ces métaux lourds. Et tous ceux qui se nourrissent de ces denrées alimentaires sont contaminés où qu’ils se trouvent.
.jpeg)




.jpg)

.jpeg)
.jpeg)


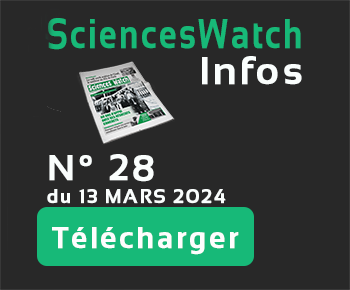












Commentaires 0