Pour le Coordonnateur régional du programme Liste Verte d’Afrique centrale et occidentale, malgré les défis, il espère qu’après l’atelier de Yaoundé, le processus va attirer les décideurs. Il a accordé un entretien à Sciences Watch Infos le 11 novembre.
Qu’entend-on par Liste Verte ?
La Liste Verte est un label que l’Union internationale pour la conservation de la nature attribue aux aires protégées qui sont reconnues pour la qualité de gouvernance et d’efficacité de gestion. C’est le seul outil qui met ensemble, la gouvernance et l’efficacité de gestion. Son importance est d’abord stratégique, parce que la Liste Verte a été reconnue par la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité comme étant l’outil essentiel qui va aider les Etats à atteindre les objectifs du Cadre mondial sur la biodiversité à l’horizon 2030, notamment sa cible 3 qui est basée sur l’efficacité de gestion et la qualité de gouvernance. Au niveau national, la Liste Verte permet de reconnaître la qualité de certaines aires protégées en termes de gestion et de gouvernance qui ne sont pas connues à l’échelle internationale. En Afrique, au-delà des sites du Patrimoine mondial et des réserves de biosphère, il y a d’autres sites qui sont bien gérés alors qu’ils ne sont, ni sites du Patrimoine mondial ni site Ramsa. La Liste verte est un outil qui vient démocratiser la labélisation au niveau des aires protégées. Aujourd’hui, avoir le statut du Patrimoine mondial ou de site Ramsar requiert des exigences surtout en termes de valeurs spécifiques qu’on ne trouve pas dans n’importe quel site. Ce qui veut dire que n’importe quelle aire protégée peut avoir le label Liste Verte à condition que la qualité de gestion et de gouvernance soit bonne.
Quels sont les éléments qui rentrent dans la qualité de gestion ?
Il faut d’abord avoir un organe de gestion performant. La performance est évaluée sur la base des outils utilisés, sur sa gestion qui transparaît dans l’évaluation faite à partir des outils. Il y a le mécanisme de financement étant donné que la gestion d’une AP a un coût. Le financement durable fait partie des outils. Il y aussi la valorisation ; aujourd’hui on gère les aires protégées pour préserver la biodiversité, certes, mais aussi pour promouvoir le développement socio-économique des communautés riveraines.
Y a-t-il les cas où l’implémentation de la Liste Verte a connu du succès ?
Le processus a démarré en 2014. Seulement, en Afrique, le Kenya et l’Egypte sont les pays qui se sont engagés aussitôt. Ce qui fait qu’à l’échelle mondiale, à date, il n’y a que ces deux pays-là qui comptent des sites qui sont inscrits. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, le processus a été lancé en 2017 et l’on compte 12 sites qui sont très avancés dans le processus et dont les candidatures pourraient être soumises au premier semestre de 2025. En Afrique centrale, malgré la richesse des aires protégées, avec l’importance qu’on reconnaît au Bassin du Congo, il n’y a que la République Démocratique du Congo (RDC) qui a commencé le processus. D’où l’importance de cet atelier et nous pensons qu’au terme de celui-ci, nous allons commencer à développer des processus en Afrique centrale. Nous sommes convaincus, à la lumière de notre outil IMET proposé par le programme BIOPAMA, que plusieurs Etats vont rallier cette cause.
Quels sont les défi de ce processus ?
Les défis sont énormes mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir les relever. Le premier défi est celui de l’engagement politique. Si le politique n’est pas engagé dans le processus, ce n’est pas évident que ce soit durable. Le processus a besoin d’un appui politique parce que, n’oublions pas que la Liste Verte a été identifiée comme un outil essentiel de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. Tous les pays qui prennent part à cet atelier ont ratifié cette convention, cela veut dire que logiquement, nous sommes en phase avec les engagements de nos politiques à l’échelle internationale. Le deuxième défi c’est de mettre en place un cadre opérationnel au niveau des sites qui va permettre à l’ensemble des aires protégées de préparer leur dossier de candidature pour la Liste Verte. Le troisième défi, c’est l’appui technique ; l’UICN est là, son rôle est d’accompagner les Etats qui vont s’engager pour ce processus et le dernier défi c’est le financement ; le processus Liste Verte va de trois à cinq ans donc on a besoin de suffisamment de ressources qui vont dépendre des progrès que nous allons enregistrer.






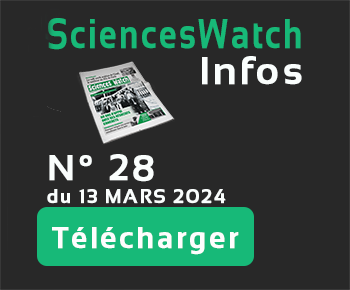












Commentaires 0