La communauté internationale commémore ce 11 décembre, la journée mondiale des droits de l’Homme sur le thème : « Nos droits, notre avenir, dès maintenant ». Le Cameroun et l’Afrique ont uni leur voix pour cette commémoration, au lendemain de la fin des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre. Des violences dont la restriction du droit d’accès des femmes et des filles aux services de santé de reproduction demeure questionné, malgré les lourdes conséquences enregistrées.

D’après le rapport du Guttmacher Institute, signé par Akinrinola Bankole, Lisa Remez, Onikepe Owolabi, Jesse Philbin et Patrice Williams, 40 femmes sur 1 000 âgées de 15 à 49 ans, pratiquent un avortement chaque année. Dans ce travail paru en 2020, les auteurs indiquent que dans les pays où la loi est moins restrictive, moins de 1% des avortements sont considérés comme dangereux. Cependant, dans les pays aux lois restrictives, comme ceux d’Afrique subsaharienne, 31% de cas d’avortement sont non-sécurisés, représentant 77% des 45% décomptés dans le monde entre 2010 et 2014. Des chiffres qui ont d’importantes conséquences sur la mortalité maternelle, encore élevée dans cette partie du monde. Loin de la cible de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes fixée par les objectifs de développement durable (ODD), -précisément le troisième- de l’Organisation des Nations Unies. Ces ODD engagent les Etats du monde à réduire la mortalité maternelle d’ici 2030, au taux susmentionné. De plus, le taux d’accès à la contraception reste bas, 19,3% à en croire l’Enquête démocratique de santé (EDS) de 2018.
En outre, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le manque d’accès à des soins d’avortement sécurisés, en temps opportun, à un coût abordable et respectueux, constitue un problème majeur de santé publique et une question de droits humains. « Environ 45 % de l’ensemble des avortements sont non sécurisés, dont 97 % ont lieu dans les pays en développement. L’avortement non sécurisé constitue l’une des principales causes – mais évitables – de décès maternels et de morbidité. Elle peut entraîner des complications physiques et mentales ainsi qu’une charge sociale et financière pour les femmes, les communautés et les systèmes de santé ». Elle révèle par ailleurs qu’en 2003, l’Afrique a enregistré 8,3 millions d’avortement non-sécurisés dans la tranche 15-24 ans.
13 à 40% des complications dans les services de maternité sont attribuables aux avortements à risques
Ces données alarmantes ne laissent pas indifférents les dirigeants africains. Ceux-là même qui ont signé un engagement pour l’amélioration de la situation, notamment le Protocole de Maputo. En son Article 14(2)c, il rappelle que : « pour protéger la santé et les droits reproductifs des femmes, l’avortement sécurisé doit être autorisé lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme, lorsque sa santé physique ou mentale est menacée, lorsque la grossesse résulte d’une agression sexuelle, d’un viol ou d’un acte d’inceste et lorsque le fœtus présente une malformation grave ».
Ce document, adopté en 2003, s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’Union africaine pour les droits de l’Homme. Il épouse certains contours des lois nationales dont le code pénal du Cameroun en son article 239 qui autorise l’avortement pour des cas de viol et de menace de la santé de la mère, à condition qu’une commission le constate.
Cependant, cette procédure n’est pas sans conséquences pour les victimes, étant donné sa durée qui peut correspondre à celle nécessaire pour qu’une grossesse arrive à terme. D’où le plaidoyer porté par la Société des gynécologues-obstétriciens du Cameroun (SOGOC), connu sous le nom de : « Advocacy for Compréhensive Abortion Care » (ACAC). Il est question de demander aux décideurs d’appliquer les textes, le Protocole de Maputo et le Code pénal afin d’offrir les services d’avortement sécurisé à ceux qui en ont le droit.
Ce décalage entre les textes et la réalité est observé dans la plupart des pays ayant signé le Protocole de Maputo. Pour accorder ce droit à ceux qui le méritent, le cercle de la mobilisation s’élargit. 406 décès pour 100.000 naissances vivantes sont notifiés chaque année au Cameroun. Selon les résultats d’une étude conduite par la SOGOC et qui attendent d’être validés, 13 à 40% des complications dans les services de maternité sont à attribuer aux avortements à risques.
Depuis Abidjan, journalistes, blogueurs et influenceurs dans la course autour d’une Task Force

Benn Michodigni
Benn Michodigni, journaliste, est le tout premier coordonnateur de la Task Force des journalistes, blogueurs et influenceurs mise sur pied à l’issue de l’atelier de co-création tenu à Abidjan du 18 au 22 novembre dernier par l’Organisation pour le dialogue sur l’avortement sécurisé (ODAS) et ses partenaires. De nationalité béninoise, il sait déjà ce qui l’attend et rassure. « Je m’engage pour la vision qui est de permettre à toutes les femmes et les filles d’avoir droit à un avortement sécurisé, lorsque ce sont des cas éligibles. Nous allons nous investir dans cette mission avec le soutien de tout le groupe et d’autres collègues qui n’ont pas pris part aux travaux d’Abidjan », a-t-il déclaré. « Dans la mise en œuvre du plan d’action que nous avons élaboré à Abidjan, a relevé le coordonnateur de la Task Force, nous envisageons que dans les rédactions, l’on puisse créer des desks santé et spécialement des espaces dédiés aux droits sexuels et à la santé de reproduction, surtout l’avortement sécurisé pour les cas éligibles, afin que le Protocole de Maputo, signé par des Etats et ratifiés par d’autres, puisse être respecté. » Et d’ajouter pour trancher : « Le non-accès à l’avortement sécurisé par des femmes et filles éligibles est pour moi une violence basée sur le genre (VBG), étant donné que les textes prévoient que les femmes éligibles puissent avoir droit à ce service. Si ceci leur est refusé, il s’agit d’une violation de leur droit et c’est une VBG. »
« Nous avons abordé un certain nombre de sujets, comment écrire des articles, comment communiquer sur les droits sexuels et la santé de reproduction, les concepts nécessaires, les défis, etc. Nous avons essayé d’identifier et de définir un plan d’action de la liste de travail. On pourra davantage approfondir d’abord les aspects pratiques à la rédaction. Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour aller dans l’aspect pratique, peut-être que toutes ces activités pourraient permettre d’avoir des résidences pour la production et permettre donc d’y donner un aspect concret. Les sujets qu’on a déjà identifiés doivent être planifiés. Cela constitue une base pour les journalistes, ça leur permet de voir comment ils peuvent déjà les traiter dans leur rédaction. Et le plan d’action nous permet déjà de pouvoir améliorer l’environnement relatif aux droits sexuels et à la santé de reproduction », a signalé le Dr Isaac Hougnigbe, facilitateur de l’atelier d’Abidjan.
Réactions
- Perline Noudjimadji, journaliste reporter d’images au Tchad
Il faut parler de l’avortement sécurisé

Perline Noudjimadji
Les journalistes doivent continuer à parler de la violence basée sur le genre parce que les femmes et les filles sont toujours violentées. Chaque jour, chaque heure, elles meurent à cause desdites violences. Dans le monde, dans nos pays, les femmes décèdent. Les journalistes doivent toujours en parler parce que ce sont eux qui donnent l’information quand les femmes sont violées, frappées. Si l’on se tait, cela va s’accentuer et les femmes qui meurent laissent des enfants dans la détresse. Parler en tant que journaliste, c’est combattre ces VBG ; c’est porter la voix des femmes au-delà. La forme la moins abordée par les médias est la santé de la reproduction ; parler de l’excision, etc. Il faut parler de l’avortement sécurisé parce que les femmes, celles devant bénéficier des cas éligibles, meurent parce qu’elles se sont engagées sur la voie de l’avortement non médicalisé faute de recevoir le service qui leur était dû.
- Maïmouna Gueye, journaliste au Sénégal
On peut défendre ces droits de plusieurs manières

Maïmouna Gueye
Je pense que les femmes doivent avoir droit aux services de santé de la reproduction à tous les droits y compris celui-là. Si ces droits-là sont violés, on est bien en passe de qualifier cela de violence basée sur le genre. Il y a des restrictions dans nos pays. Il faut que les journalistes aillent doucement. Je pense même qu’il n’y a pas de problème, c’est nous qui en créons. Nous devons parler autrement, peut-être en attirant l’attention des autorités qui n’étaient même pas attentives à ce genre de choses. Il faut qu’on en parle. Nous sommes des journalistes, nous sommes habitués à écrire sur ces questions-là. On va continuer à en parler pour le respect des droits des femmes. Les féministes en parlent, d’accord, c’est bien. Mais on n’a pas besoin de l’afficher. Moi, je défends les droits des femmes ; on peut défendre ces droits de plusieurs manières ; parler de la santé de reproduction, de la planification familiale, de l’avortement sécurisé. C’est en défendant la cause des femmes qu’on peut faire évoluer les mentalités.
- Ponellia Chabossou, Bénin
Prendre les décisions concernant sa vie

Ponellia Chabossou
Je dirai que priver quelqu'un de ses droits est une violation, d'où une violence basée sur le genre. On n'est pas libre si on ne peut prendre des décisions concernant son corps et son bien-être. Toute personne a le droit de prendre les décisions concernant sa vie. Les restrictions à l’avortement sécurisé peuvent entraîner de graves violations des droits des femmes.
Il y a des restrictions étatiques

Yvette B. Mendy
La santé de la reproduction est un droit pour chaque femme. Celle-ci doit utiliser son corps comme elle entend. Cela doit être encadré certes mais il faut donner la possibilité à la personne elle-même de faire son choix et je pense que si tel est le cas, elle le fera de façon judicieuse parce que tout ce qui arrive à son corps, elle le subit personnellement et elle est plus à même des choix raisonnables, éveillés et en toute franchise.
Ce n’est pas facile dans mon pays, parce qu’en dehors des restrictions religieuses, il y a des restrictions étatiques alors même que le pays a ratifié le protocole de Maputo en 2005. Or, je pense qu’en le ratifiant sans réserve, l’Etat prenait là des engagements pour ses populations. Des engagements qui ne sont pas jusqu’ici respectés. Malheureusement, le code pénal interdit de parler d’avortement bien qu’il soit permis avant le premier trimestre de la grossesse en cas de viol et d’inceste. C’est une cause qui doit mobiliser tout le monde au vu des conséquences ; qu’on le dise ou non, lorsque des femmes veulent avorter, elles le feront à leurs risques et périls. Il faut faire encadrer cela pour le bien de la population.
-
Bibiche Mbete, République Démocratique du Congo
Encore vulgariser ce protocole

Bibiche Mbete
En RDC, les données révèlent que l’avortement est une des causes principales des décès des femmes lors de l’accouchement. Les femmes n’ayant pas eu accès à l’avortement sécurisé pendant longtemps, s’adonnent aux pratiques à risques. Le protocole de Maputo a ouvert une porte pour que les femmes aient accès à ce service en 2008. Mais depuis 1940, le code pénal interdit l’avortement quelles qu’en soient les causes et les raisons. Des médecins qui ont osé le faire se sont retrouvés en prison. On a mené des plaidoyers, une brève s’est ouverte pour que des femmes présentant des problèmes de santé bénéficient de l’avortement sécurisé. Il a fallu attendre 2018, 10 ans après la signature du Protocole de Maputo, par le président Joseph Kabila intervenue en 2008 après l’adoption par les parlements en 2006, pour que le Conseil supérieur de la magistrature se serve de la disposition de la constitution qui indique que lorsque des lois internationales ratifiées par la RDC sont publiées dans le journal officiel, ils ont automatiquement un caractère suprême sur les lois nationales. C’est donc la publication du Protocole de Maputo en 2018 qui a amélioré les choses. Mais, il faut encore vulgariser ce protocole parce que même les médecins ignorent que les choses ont changé.













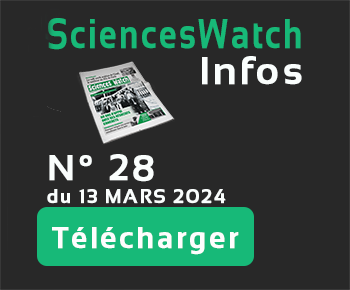











Commentaires 0